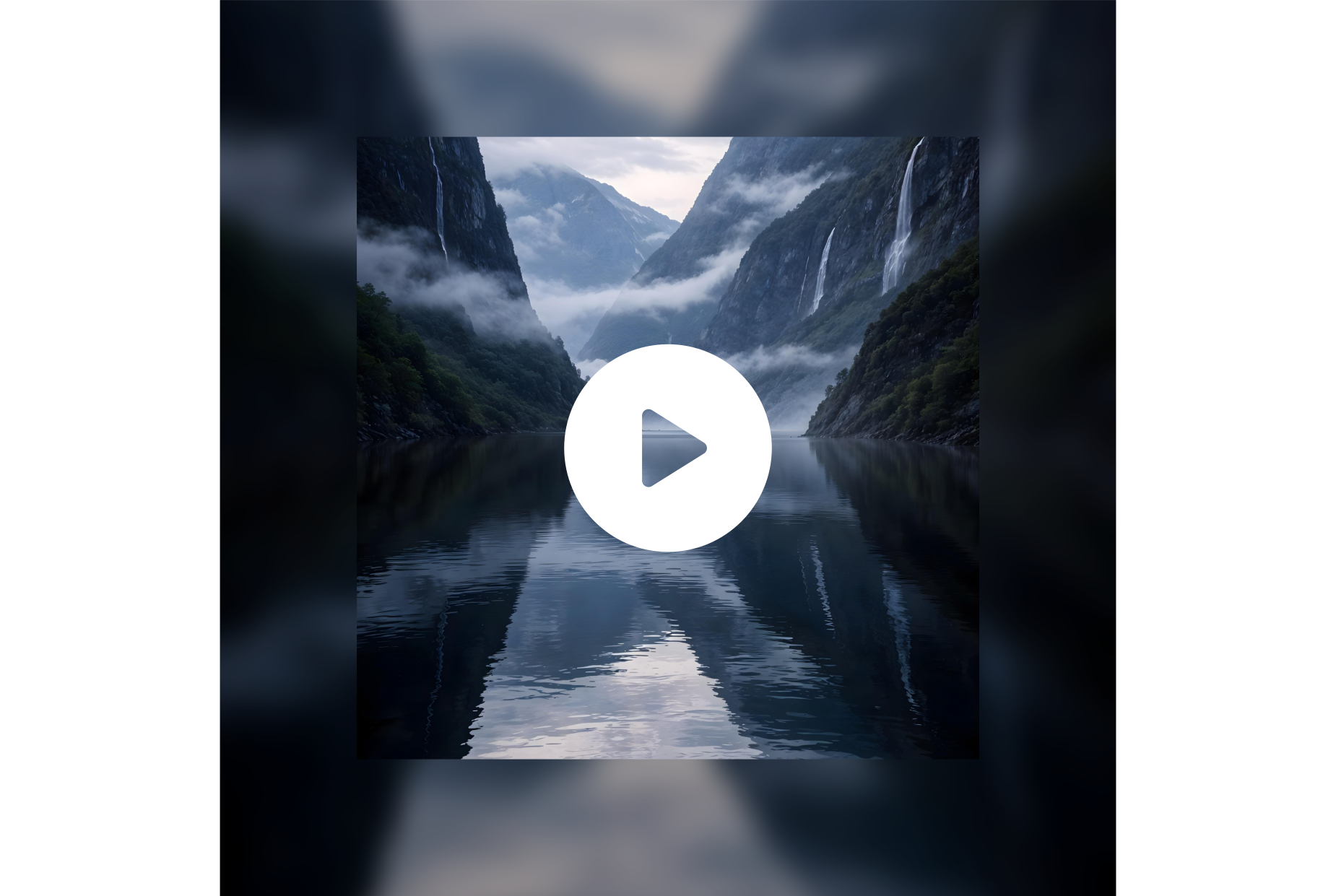Nous traversons la vie emplis de certitudes. Nos convictions façonnent nos émotions et nos actions au quotidien, dans nos relations, nos choix professionnels, nos débats... Pourtant, ces « vérités » que nous portons en nous sont souvent construites sur des bases fragiles ! Socrate soulignait déjà le danger de cette illusion de savoir : « Ce que je sais, c’est que je ne sais rien. » Cette formule célèbre reflète une sagesse profonde : reconnaître ses propres limites et admettre que la connaissance humaine est toujours imparfaite.
« Cet homme-là, moi, je suis plus sage que lui. Car il y a certes des chances qu’aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon ; mais lui croit savoir quelque chose, alors qu’il ne sait rien, tandis que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. »
Cette attitude d'humilité nous invite à douter de nos propres certitudes, à ne jamais considérer nos opinions comme des vérités absolues. Admettre notre ignorance est déjà un signe de sagesse, car cela ouvre la voie à la recherche continue et infinie de la vérité. Dans un monde où l'accès à l'information est quasi illimité, cette leçon socratique est plus pertinente que jamais. Les certitudes sont partout : sur les réseaux sociaux, dans les médias, au sein des discussions politiques, ou même dans les choix de vie. La facilité avec laquelle nous émettons des jugements ne garantit en rien leur véracité.
Notre regard se laisse prendre par l’apparente évidence du monde, comme si ce dernier se donnait d’emblée, immédiat et tangible, prêt à être saisi. Illusion, pourtant, que cette naïveté des sens. Ce que nous voyons n’est jamais simple ni vierge. Chaque culture, chaque langue, chaque héritage façonne notre perception bien au-delà de ce que nous pensons. Nous ne voyons pas seulement avec nos yeux : nous voyons avec ce qui nous précède, avec ce qui nous a été transmis, consciemment ou non, comme un filtre invisible et omniprésent.
Notre perception, donc, est toujours limitée. Et l’une des plus grandes barrières à notre compréhension du monde est le langage lui-même. La langue qui est la nôtre est porteuse d'une précompréhension. « Avant que ne commence la pensée philosophique critique, le monde s'est déjà interprété dans une langue. C'est en apprenant une langue, en grandissant dans notre langue maternelle que s'articule pour nous le monde. Cela est moins un égarement qu'une première ouverture », écrit Gadamer.
Depuis notre premier souffle, nous héritons de mots, de concepts, de structures qui façonnent notre vision de la réalité. Nous naissons dans des mots, grandissons dans des phrases, vieillissons dans des significations qui nous précèdent. C’est à travers notre langue maternelle que nous apprenons à nommer les choses, mais aussi à les limiter. Car chaque mot, chaque expression, est un cadre qui inclut autant qu’il exclut. L’expérience montre qu'apprendre une nouvelle langue ne se résume pas à changer des mots par d’autres mots : c'est penser autrement, et aussi voir autrement. Apprendre une langue, c’est se fondre en elle, adopter sa manière de découper le réel, de penser l’existence.
Cette appartenance au monde par le langage fait qu'il ne saurait y avoir de regard pur, de vision innocente. On voit en fonction de ce en quoi on a déjà été initié. Il n'y a pas de regard vierge de toute attente préalable ; il n'y a pas de regard sans présupposés. C'est pourquoi vouloir voir et expliquer les choses telles qu'elles sont, sans rien y ajouter de soi-même, est insensé.